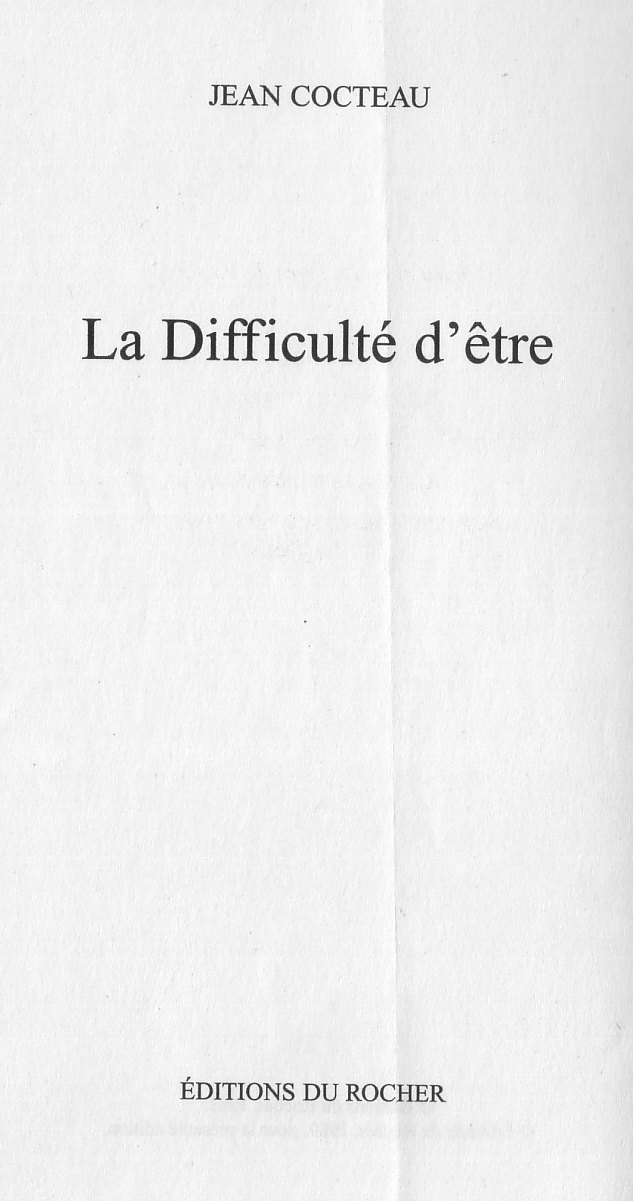|
|
|||||||||||||||
Frédéric GIMELLO-MESPLOMB, Maître de conférences |
||||||||||||||||
| f |
||||||||||||||||
|
Jean Cocteau : Du merveilleux au cinématographe (in "La difficulté d'être", 1957) 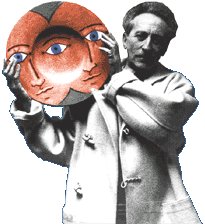
Je veux qu'on me reconnaisse à mes idées, ou mieux, à ma démarche. DU MERVEILLEUX AU CINÉMATOGRAPHE
On parle beaucoup du merveilleux. Encore faudrait-il s'entendre et savoir ce qu'il est. S'il me fallait le définir, je dirais que c'est ce qui nous éloigne des limites dans lesquelles il nous faut vivre et comme une fatigue qui s'étire extérieurement à notre lit de naissance et de mort. Il y a une erreur qui consiste à croire que le cinématographe est un art propre à mettre en ouvre cette faculté de l'âme. L'erreur provient d'une hâte à confondre le merveilleux et la prestidigitation. Ce n'est pas grande merveille que de sortir une colombe d'un chapeau. La preuve en est que cette sorte de tour s'achète, s'enseigne et que ces miracles d'un sou suivent des modes. Ils ne relèvent pas davantage du merveilleux que l'algèbre, mais en offrent une apparence frivole et plaisante, de moindre fatigue pour l'esprit. Est-ce dire que le cinématographe ne peut mettre en la main une arme capable de dépasser la cible? Non. Mais s'il en est capable, il l'est au même titre que les autres arts dont on tâche de l'exclure parce que sa jeunesse le rend suspect dans un pays (la France) où, sauf s'il s'agit d'en défendre le territoire, on ne la prend pas en considération. Le cinématographe a cinquante ans. C'est, hélas, mon âge. Beaucoup pour moi. Fort peu pour une Muse qui s'exprime par l'entremise de fantômes et d'un matériel encore en enfance si on le compare à l'usage de l'encre et du papier.
II est probable que la phrase « Écrivez donc sur le merveilleux au cinématographe » vient des films Le. Sang d'un poète et La Belle et la Bête, imaginés à quinze ans d'intervalle et dans lesquels on s'accorde à voir la mise en ouvre de cette curiosité qui nous pousse à ouvrir des portes interdites, à marcher dans le noir en chantonnant pour se donner du cour. Or, Le Sang d'un poète n'est qu'une descente en soi-même, une manière d'employer le mécanisme du rêve sans dormir, une bougie maladroite, souvent éteinte par quelque souffle, promenée dans la nuit du corps humain. Les actes s'y enchaînent comme ils le veulent, sous un contrôle si faible qu'on ne saurait l'attribuer à l'esprit. Plutôt à une manière de somnolence aidant à l'éclosion de souvenirs libres de se combiner, de se nouer, de se déformer jusqu'à prendre corps à notre insu et à nous devenir une énigme. Rien de moins propre que la France à l'exercice de cette faculté qui n'a recours ni à la raison ni aux symboles. Peu de Français veulent jouir d'un événement exceptionnel sans en connaître la source, le but, ni le mettre à l'étude. Ils préfèrent en rire et le traiter par l'insulte. Le symbole est leur dernier recours. Il leur donne de la marge. Il leur permet encore d'expliquer l'incompréhensible et de revêtir d'un sens caché ce qui tire sa beauté à n'en pas avoir. « Pourquoi? Vous moquez-vous? De qui vous moquez-vous ? » sont les armes que la France oppose à la forme inédite qu'une âme hautaine arrive à prendre lorsqu'elle se manifeste contre toute attente et intrigue quelques curieux. Ces quelques curieux passent vite pour être de mèche. Il arrive que les snobs, qui ont hérité du flair des rois, les suivent à l'aveuglette. Cela compose un mélange auquel le public se refuse, incapable de reconnaître les signes d'un nouveau conformisme embryonnaire auquel il souscrira demain. Et ainsi de suite. Le merveilleux serait donc, puisqu'un prodige ne saurait être un prodige que dans la mesure où un phénomène naturel nous échappe encore, non pas le miracle, écourant par le désordre qu'il détermine, mais le simple miracle humain et fort terre à terre qui consiste à donner aux objets et aux personnages un insolite qui échappe à l'analyse. Comme nous le prouve Vermeer de Delft. Ce peintre peint certes ce qu'il voit, mais cette exactitude, plaisante à tous, nous renseigne sur ce par quoi il s'en écarte. Car s'il n'use d'aucun artifice pour nous surprendre, notre surprise n'en est que plus profonde en face des singularités qui lui valent sa solitude et nous interdisent la moindre comparaison entre son ouvre et celle de ses contemporains. Un peintre de la même école peint avec la même franchise. Il est dommage que sa franchise ne nous livre aucun secret. Chez Vermeer l'espace est peuplé d'un autre monde que celui qu'il représente. Le sujet de son tableau n'est qu'un prétexte, un véhicule par où s'exprime l'univers du merveilleux. J'en voulais venir à cela : que le cinématographe peut s'apparenter au merveilleux tel que je l'envisage s'il se contente d'en être un véhicule et s'il ne cherche pas à le produire. L'espèce de ravissement qui nous transporte au contact de certaines ouvres provient rarement d'un appel aux larmes, d'un effet de surprise. Il est plutôt, je le répète, provoqué de manière inexplicable par une brèche qui s'ouvre à l'improviste. Cette brèche se produira dans un film au même titre que dans une tragédie, un roman ou un vers. Le ravissement ne viendra pas des facilités qu'il offre aux stratagèmes. Il viendra de quelque faute, de quelque syncope, de quelque rencontre fortuite entre l'attention et l'inattention de son auteu. Pourquoi en userait-il autrement que font les Muses? Son aptitude à tromper l'oil et l'esprit trompe aussi sur ses titres de noblesse.
Le cinématographe est un art. Il se délivrera de l'esclavage industriel dont les platitudes ne l'incriminent pas plus que les mauvais tableaux et les mauvais livres ne discréditent la peinture et les lettres. Mais, de grâce, n'allez pas le prendre pour un magicien. C'est ainsi qu'on a coutume de parler d'un travailleur, évitant par ce terme d'approfondir ses entreprises. Son privilège n'est pas de tours de cartes. Il passe outre la jonglerie. Elle n'est que sa syntaxe. C'est ailleurs qu'il faut saluer le merveilleux. Le Sang d'un poète n'a rien de magique, ni La Belle et la Bête. Les personnages de ce dernier film obéissent à la règle des féeries. Rien ne les étonne dans un monde où sont admises comme normales des choses dont la moindre fausserait les mécanismes du nôtre. Lorsque le collier de Belle se change en vieille corde, ce n'est pas un tel prodige qui révolte ses sours, mais qu'il se change en corde parce qu'elles le touchent. Et s'il se trouve du merveilleux dans mon film, ce ne sera pas de ce côté qu'il faudra l'attendre, mais il se montrera plutôt dans les yeux de la Bête lorsqu'elle dit à Belle : « Vous me flattez comme on flatte un animal », et qu'elle lui répond : « Mais vous êtes un animal. » Une paresse en robe de juge condamne dans nos entreprises de poésie ce qu'elle estime n'être pas poétique, se basant, pour son verdict, sur cette apparence de merveilleux dont je parle, et sourde au merveilleux s'il n'en porte pas les attributs. Lorsqu'on voit les fées, elles disparaissent. Elles ne nous assistent que sous un aspect qui nous les rend illisibles et seulement présentes par la soudaine grâce insolite d'objets familiers en quoi elles se déguisent pour nous tenir compagnie. C'est alors que leur aide devient efficace et non lorsqu'elles apparaissent et nous étourdissent de lumières. Il en va de même pour toutes choses. Dans La Belle et la Bête, je n'ai pas adopté cette pente que le public veut descendre de plus en plus vite sans qu'on lui ménage son vertige.
Je m'obstine à le redire : Merveilleux et Poésie ne me concernent pas. Ils doivent m'attaquer par embuscade. Mon itinéraire ne doit pas les prévoir. Si j'estime que tel terrain d'ombre est plus favorable qu'un autre à les abriter, je triche. Car il advient qu'une route découverte et au grand soleil les abrite mieux. C'est pourquoi je m'attache autant à vivre dans la famille de Belle que dans le château de la Bête. C'est pourquoi l'allure féerique m'importe davantage que la féerie en soi. C'est pourquoi l'épisode, entre autres, des chaises à porteurs dans la basse-cour, épisode qui ne relève d'aucun fantasme, est, à mon gré, plus significatif de cette allure que tel artifice du château. Dans Le Sang d'un poète, le sang qui coule au travers du film dérange nos juges. A quoi bon, se demandent-ils, nous dégoûter et nous choquer exprès ? Ce sang qui nous écoure nous oblige à détourner la tête et nous empêche de jouir des trouvailles (par trouvailles ils entendent : l'entrée dans la glace, la statue qui bouge, le cour qui bat), mais de l'une à l'autre de ces secousses qui les réveillent, quel lien, je vous le demande, sinon ce sang qui coule et duquel le film emprunte son titre? Que savent-ils du fleuve, eux qui ne veulent jouir que d'escales? Et que vaudraient ces « trouvailles », comme ils disent, si elles n'étaient la conséquence d'une architecture, même inconsciente, et tributaire du reste par ce lien du sang? Ils dorment et pensent que je dors et que mon réveil les réveille. D'un repas, leur lourdeur les condamne à ne plus distinguer que le poivre. Ils ne sentent plus que les pointes. C'est ce qui les enfièvre, leur donne la bougeotte, les oblige à courir de lieu en lieu. Dans L'Éternel retour, le château des amants leur semble propre à la poésie. Le garage du frère et de la sour impropre. Ils le condamnent. Étrange sottise. Car c'est justement dans ce garage que la poésie fonctionne le mieux. En effet, à comprendre l'abandon du frère et de la sour, à leur méconnaissance innée et comme organique de la grâce, on la touche du doigt et j'approche des terribles mystères de l'amour. Voilà le fruit de quelques expériences que j'ai faites, auxquelles je me livre encore et qui sont le seul objet de mes recherches. Comme le dit Montaigne : « La plupart des fables d'Ésope ont plusieurs sens et intelligences. Ceux qui les mythologisent en choisissent quelque visage qui cadre bien à la fable; mais, pour la plupart, ce n'est que le premier visage et superficiel, et il y en a d'autres, plus vifs, plus essentiels et internes, auxquels ils n'ont su pénétrer. »
|
||||