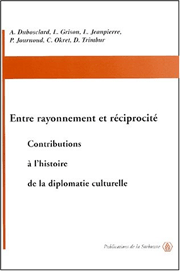|
| |||||||||||||||
| f |
||||||||||||||||
|
la diplomatie culturelle
Résumé du coursLa diplomatie est la mise au monde des Etats, leur représentation symbolique au sein de l' espace public international . Les luttes d'influence et de pouvoir entre les grandes nations de la planète ont toujours traversé et structuré cet espace politique. Or, depuis une dizaine d'années, ce mouvement semble s'accélérer, porté par le phénomène complexe et croissant de la mondialisation . Dans ce nouveau contexte, on peut observer l'émergence de nouveaux acteurs et de nouveaux enjeux. Ainsi les « mouvements citoyens » naissants, comme les représentations culturelles diplomatiques s'appliquent à défendre un droit nouveau des peuples, celui de la liberté de leurs imaginaires. En effet, la mondialisation des productions des industries culturelles, dominée par le marché d'exportation américain est souvent vue, à juste titre, comme antagoniste à la pérennité de la diversité des cultures. Les productions cinématographiques des autres Etats ayant de plus en plus de difficultés à survivre sur le marché mondial du film. D'autre part, le contexte international, issu des bouleversements politiques et stratégiques du XXème, ne laisse aux nations que peu de champ d'action au sein de l'espace public international. La culture apparaît alors comme un des derniers vecteurs d'influence, c'est à dire dernier mode d'expression international. Consciente de ce nouvel enjeu de géopolitique de la culture, la France, la première, met en oeuvre une politique culturelle internationale afin de soutenir son poids politique à travers le monde, c'est la diplomatie culturelle . Outil de visibilité, la diplomatie culturelle s'efforce de promouvoir les créations artistiques françaises de par le monde. Outil politique, elle prend une part de plus en plus conséquente et de plus en plus active au sein de la politique internationale de la France. Fondée sur la réciprocité entre les nations et la coopération bilatérale, la diplomatie culturelle oeuvre à la stabilité des relations internationales et soutient de nouveaux enjeux à valeur universelle. Ainsi, en défendant la place de sa culture sur la scène internationale, la France promeut l'idée de la diversité culturelle, c'est à dire du respect des autres et de leurs choix d'organisation sociale de leur société, de leur modèle de développement, de la langue qu'ils désirent parler. Cette ambition de pluralisme culturel se traduit, en termes politiques, en une aspiration à un monde multipolaire, c'est à dire dont les forces d'influence et de pouvoir seraient redistribuées. La diplomatie culturelle est donc une discipline émergente et prometteuse en terme de politique internationale.
Plan du cours :
Ouvrage de référence :
Alain DUBOSCLARD, Laurent G RISON , Laurent JEAN-PIERRE, Pierre JOURNOUD, Christine OKRET, Dominique TRIMBUR . Entre rayonnement et réciprocité. Contributions à l'histoire de la diplomatie culturelle . Publications de la Sorbonne, Paris, 2002, 197 pages, 18€. ISBN: 2859444661 Préface de Pascal Ory (Paris I - Sorbonne); postface d'Akira Iriye (Harvard University)
Présentation de l'éditeur: À l'heure actuelle, la culture est devenue un des principaux enjeux de circulation économique, les sphères culturelles sont le lieu de concurrence et de concentration transnationales inédites, les processus de mondialisation touchent désormais tous les continents: il paraît donc nécessaire d'interroger l'histoire des relations culturelles internationales au long du XX e siècle. Il semble qu'après la Première guerre mondiale, l'Occident ait inventé un nouvel instrument politique extérieur, une diplomatie d'un nouveau type où s'articulent autrement la volonté de puissance des États-nations et les champs de production symbolique. À côté d'initiatives privées, l'appareil d'État a ainsi tenu une place décisive dans l'exportation des cultures nationales, la mise en place de réseaux et d'institutions visant à internationaliser les sciences, la culture et la formation des élites culturelles. L'ouvrage s'intéresse à la montée en puissance de cette diplomatie culturelle occidentale jusqu'à la fin des années 1970 lorsqu'elle est contrainte de redéfinir ses tâches devant d'autres processus, plus massifs, l'internationalisation. En de brefs essais qui touchent aussi bien la politique culturelle française au Proche-Orient et aux États-Unis, que la présence britannique en France via les «British Council» ou la comparaison des politiques culturelles française et américaine au Viêt-nam, l'ouvrage rappelle qu'il y eut deux pôles majeurs, peut-être successifs, de la diplomatie culturelle au XX e siècle: des politiques du rayonnement et des politiques de la réciprocité entre lesquelles on n'a cessé d'osciller. Il permet aussi d'insister sur la multiplicité des outils institutionnels de l'action culturelle extérieure. À travers l'objet «diplomatie culturelle», il propose de s'interroger en retour sur les identités nationales, en particulier sur leurs crises. Une attention particulière est accordée à deux chantiers historiographiques brûlants dont l'écho est persistant dans l'actualité de ce début de XXI e siècle: la politique française pendant la Seconde guerre mondiale et l'attitude de la diplomatie française dans la Palestine mandataire. Entre rayonnement et réciprocité se présente comme une étape d'une généalogie de la mondialisation culturelle, qui est un des aspects les plus méconnus des politiques étrangères des États-nations au XX e siècle. L'ouvrage offre donc un aperçu de ce que pourrait être, à la jonction de l'histoire culturelle et de l'histoire des relations internationales, une histoire de la diplomatie culturelle, qui reste encore à élaborer.
__________________________________________
article de réflexion :
Economisme ou volonté de « rayonnement » ? La diplomatie culturelle de la France à vau-l’eau
Il règne, dans les services culturels des ambassades de France à l’étranger, un parfum de désenchantement. « La grève historique et pourtant improbable du 1er décembre 2003 des personnels du ministère des affaires étrangères a été suivie à plus de 70 %. Inimaginable », souligne cet ancien conseiller culturel récemment reconverti à l’entreprenariat privé. Et d’ajouter : « Cela fait des années que nous laissons croire à nos interlocuteurs que nous disposons de moyens pour mener une politique culturelle extérieure ambitieuse (1). Or c’est faux. Non seulement nous n’en avons pas, mais nous laissons croire publiquement le contraire. C’est une imposture. » Diplomatie oblige, la loi du silence prévaut, mais, quand elle est transgressée, au hasard des colloques et autres rapports de mission, elle agit comme une libération. Le rapport du député (devenu sénateur) Yves Dauge, par exemple (2) : chargé de dresser, en 1999, un état des lieux de cet impressionnant réseau qui compte 400 établissements, 7 000 agents, un millier d’Alliances françaises, et dispose d’un budget de 1,3 milliard d’euros (3), le parlementaire socialiste avait mis le feu aux poudres en pointant quelques dysfonctionnements flagrants, en particulier sur la question délicate de la gestion des ressources humaines. Quatre ans plus tard, le sénateur Louis Duvernois (divers droite), qui présentera prochainement un rapport sur le sujet, s’interroge devant nous sur « la capacité du Quai à ne jamais s’exprimer clairement sur ses intentions dans ce domaine, alors que le malaise de ses agents est connu ». Sur le terrain, les attachés des services d’action culturelle et de coopération des ambassades développent un discours schizophrénique : on monte des dossiers avec des partenaires locaux, on budgétise, on négocie... tout en sachant que les projets ont peu ou pas de chance d’aboutir. C’est le cas de plusieurs actions inscrites dans les « fonds de solidarité prioritaire » (il y en a 500 !), dispositifs destinés, entre autres, à mettre en œuvre d’ambitieux projets culturels. Mais les « gels » (moins 20 %) intempestifs de budgets – pourtant votés par le Parlement – décidés régulièrement par le ministère du budget conduisent purement et simplement certaines ambassades à ne pas honorer leurs engagements. Les autorités des pays concernés ne sont pas dupes. Mme Louise Beaudoin, qui fut ministre des relations internationales et ministre de la culture du Québec, ne cache pas son désarroi : « La France ferait mieux de dire pourquoi la chose culturelle n’est plus une priorité politique dans sa diplomatie. Si la langue française n’est pas défendue et soutenue ici, aux portes de l’Empire, c’en est fini des grandes ambitions de la francophonie. » Mêmes propos au Sud, avec Mme Aminata Traoré, ancienne ministre de la culture du Mali : « La préoccupation de la France est de soigner son image, alors que les moyens dont elle dispose pourraient être utilisés pour repenser conjointement notre développement culturel. » Les mécanismes administratifs et la manière dont sont prises les décisions au ministère posent sérieusement question. En Grèce, pays hôte des Jeux olympiques à l’été 2004, la France a fermé, en dix ans, vingt-six centres culturels sur les trente existants. L’helléniste Jacques Lacarrière ne cache pas son trouble : « La France est en train de brader l’un de nos plus fabuleux patrimoines néoclassiques installé au Pirée, en le vendant à des spéculateurs. Même si notre ambassadeur sur place ferraille contre cette décision, nos amis grecs ne comprennent pas que l’Institut français, inauguré par M. Alain Juppé en 1994, soit fermé cinq ans plus tard. » Retour de bâton : le français, pourtant langue olympique, n’a pas été retenu pour la signalétique des Jeux... Dans le même ordre d’idées, à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo, la France décide opportunément de créer en 2000 un poste d’attaché culturel adossé à la réouverture, en plein cœur de la ville, d’un centre fermé depuis dix ans. Deux ans de travaux et de négociations pour aboutir, en juillet 2003, à la fermeture (au mieux à la reconversion) d’un bâtiment entièrement rénové, disposant de 4 500 ouvrages neufs et qui aura coûté 170 000 euros. Avec, en prime, la suppression du poste d’attaché culturel ! Autre exemple, celui du réseau des Alliances françaises, institution qui vient de fêter ses 120 ans. Disposant d’un ensemble unique d’associations de droit local destinées à l’enseignement du français et à la diffusion culturelle, il pâtit de la « concurrence » des instituts ou centres culturels dépendant du même ministère des affaires étrangères, qui sont systématiquement privilégiés. Même amertume à l’Association française d’action artistique (AFAA), qui a le statut de sous-direction au ministère. Ce « laboratoire » institutionnel, dont la liberté de ton et d’initiative déplaît généralement aux ministres, est plombé par la bureaucratie. L’un de ses responsables va jusqu’à dire : « On ne parle que de budget, d’administration, de communication, mais rarement d’art et de culture, encore moins de risque artistique. Tout y est lissé, pesé, comptabilisé, contrôlé. » Ainsi, une initiative prometteuse, lancée en 1998 pour permettre à de jeunes professionnels d’intégrer le réseau culturel français à l’étranger, a été abandonnée, faute de moyens. Ce sont maintenant des stagiaires non rémunérés (dont des professeurs agrégés) qui font office de futurs professionnels bénévoles et qui, soit en poste dans une ambassade, soit sur place au ministère, effectuent un considérable travail d’animation. Contrairement à leurs prédécesseurs, ils n’ont pratiquement plus aucune chance d’être recrutés. Désormais, pour se conformer aux directives européennes, les contractuels devront, en effet, quitter leurs responsabilités au bout de quatre ans, au profit de fonctionnaires titulaires issus de l’éducation nationale. L’inconséquence de cette décision, dont personne, et pour cause, ne revendique la paternité, est lourde de conséquences : « C’en est fini des saltimbanques et des entrepreneurs culturels qui avaient permis que l’action culturelle diplomatique de la France retrouve une authentique créativité, un dynamisme communicatif », nous confie un ancien ambassadeur, passé par l’Ecole nationale d’administration (ENA). Cet avis rejoint celui des artistes et des intellectuels qui, confrontés à la réalité alarmante de la marchandisation généralisée des biens culturels, s’étonnaient depuis deux ans de l’incapacité du ministre des affaires étrangères à obtenir des arbitrages favorables pour son budget. « C’est la diplomatie qui a vampirisé la culture, et non l’inverse », constate un acteur de cinéma habitué à représenter la France à l’étranger. Les postes diplomatiques doivent non seulement gérer les contradictions du discours officiel, mais également composer avec une hiérarchie tatillonne et bureaucratique à souhait. Ainsi, la manière dont les consulats de France à l’étranger contingentent en secret l’attribution des visas d’entrée en France laisse pantois. Si, dans le passé, il y a eu quelques abus, ils ne sauraient servir de prétexte au refus opposé à beaucoup d’artistes, mais aussi à des étudiants, de travailler ou de se former en France. D’un côté, un discours d’ouverture et de promotion de la diversité culturelle tenu dans les rencontres internationales par M. Jacques Chirac en personne ; de l’autre, une réalité et une pratique sécuritaires : par souci d’efficacité, c’est auprès des services du ministère de l’intérieur et non de leurs autorités hiérarchiques du Quai d’Orsay que les consulats prennent leurs instructions... Un outil de propagande économique Deuxième hypothèse : la France doit désormais porter un discours universel unique, et cela non pas via les ambassades, mais au sein des instances qui comptent médiatiquement, à savoir, dans ce cas, l’ONU et l’Unesco, ou bien les grands sommets. De quoi « habiller » la restriction des moyens budgétaires et humains de l’action culturelle extérieure, enfermée, elle aussi, dans le carcan libéral du « moins d’Etat ». La dernière hypothèse est formulée par M. Jean-Michel Delacomptée, un ancien de la diplomatie culturelle, lorsqu’il analyse le changement d’intitulé de la direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques (DGRCST), devenue, en 1999, direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID) à la suite de l’incorporation des services de l’ancien ministère de la coopération dans celui des affaires étrangères. Cette hypothèse n’est nullement contradictoire avec la précédente : « En effaçant toute référence au culturel, la nouvelle direction générale nous plonge jusqu’au cou dans l’économisme ambiant (...), jusqu’à réduire l’action culturelle au rôle de soutier du développement et de poisson pilote de l’entreprise France (4). » Le hiatus n’a jamais été aussi profond entre, d’une part, des responsables gouvernementaux convaincus que le rayonnement culturel de la France dans le monde est compatible avec cet économisme ambiant et, d’autre part, les agents du réseau culturel extérieur, qui ne supportent plus le double discours. Jean-Michel Djian.
-------------------------------------------------------------------------------- (1) Le rapport d’activité 2001 de la direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID) du ministère des affaires étrangères affirme que « la France est plus que jamais une puissance culturelle ». (2) Assemblée nationale, Les Centres culturels français à l’étranger, rapport d’information n° 2924, commission des affaires étrangères, 7 février 2001. (3) Lire Alain Lombard, La Politique culturelle internationale, Collection internationale de l’imaginaire, n° 16, Babel, Paris, 2003. (4) Jean-Michel Delacomptée, « Coopération culturelle : la mort du livre ? », Esprit, juin 1999. LE MONDE DIPLOMATIQUE | juin 2004 | Page 28 http://www.monde-diplomatique.fr/2004/06/DJIAN/11263
_______________________________________________
BIBLIOGRAPHIE : Les enjeux de la diplomatie culturelle dans la mondialisation
Ouvrages
Revues
Articles de presse
Colloques et discours
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||